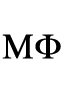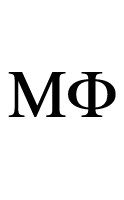Entretien avec Roger-Pol Droit
— Foucault, Michel. « Je suis un artificier. » Entretien avec Roger-Pol Droit enregistré en juin 1975.
Roger-Pol Droit : Vous n’aimez pas qu’on vous demande qui vous êtes, vous l’avez dit souvent. Je vais quand même essayer. Souhaitez-vous qu’on vous nomme historien ?
Michel Foucault : Je suis très intéressé par le travail que font les historiens, mais je veux en faire un autre.
Doit-on vous appeler philosophe ?
Pas non plus. Ce que je fais n’est aucunement une philosophie. Ce n’est pas non plus une science à laquelle on pourrait demander les justifications ou les démonstrations qu’on est en droit de demander à une science.
Alors comment vous définiriez-vous ?
Je suis un artificier. Je fabrique quelque chose qui sert finalement à un siège, à une guerre, à une destruction. Je ne suis pas pour la destruction, mais je suis pour qu’on puisse passer, pour qu’on puisse avancer, pour qu’on puisse faire tomber les murs.
Un artificier, c’est d’abord un géologue. Il regarde les couches de terrain, les plis, les failles. Qu’est-ce qui est facile à creuser ? Qu’est-ce qui va résister ? Il observe comment les forteresses sont implantées. Il scrute les reliefs qu’on peut utiliser pour se cacher ou pour lancer un assaut.
Une fois tout cela bien repéré, il reste l’expérimental, le tâtonnement. On envoie des reconnaissances, on poste des guetteurs, on se fait faire des rapports. On définit ensuite la tactique qu’on va employer. Est-ce la sape ? Le siège ? Est-ce le trou de mine, ou bien l’assaut direct ? La méthode, finalement, n’est rien d’autre que cette stratégie.
Votre première offensive, si je puis dire, c’est, en 1961, Histoire de la folie à l’âge classique . Tout est singulier dans cet ouvrage : son sujet, sa méthode, son écriture, ses perspectives. Comment l’idée de cette enquête vous est-elle venue ?
Au milieu des années 50, j’ai publié quelques travaux sur la psychologie et la maladie mentale. Un éditeur m’a demandé d’écrire une histoire de la psychiatrie. J’ai pensé à écrire une histoire qui n’apparaissait jamais, celle des fous eux-mêmes. Qu’est-ce que c’est, être fou ? Qui en décide ? Depuis quand ? Au nom de quoi ? C’est une première réponse possible.
Il y en a d’autres ?
J’avais aussi fait des études de psychopathologie. Cette prétendue discipline n’apprenait pas grand-chose. Alors naissait cette question : comment si peu de savoir peut-il entraîner tant de pouvoir ? Il y avait de quoi être stupéfait. Je l’étais d’autant plus que j’ai fait des stages dans les hôpitaux, deux ans à Sainte-Anne. N’étant pas médecin, je n’avais aucun droit, mais étant étudiant et non pas malade, je pouvais me promener. Ainsi, sans jamais avoir à exercer le pouvoir lié au savoir psychiatrique, je pouvais tout de même l’observer à chaque instant. J’étais à la surface de contact entre les malades, avec lesquels je discutais sous prétexte de faire des tests psychologiques, et le corps médical, qui passait régulièrement et prenait des décisions. Cette position, qui était due au hasard, m’a fait voir cette surface de contact entre le fou et le pouvoir qui s’exerce sur lui, et j’ai essayé ensuite d’en restituer la formation historique.
Il y avait donc, de votre part, une expérience personnelle de l’univers psychiatrique…
Elle ne se limite pas à ces années de stage. Dans ma vie personnelle, il se trouve que je me suis senti, dès l’éveil de ma sexualité, exclu, pas vraiment rejeté, mais appartenant à la part d’ombre de la société. C’est tout de même un problème impressionnant quand on le découvre pour soi-même. Très vite, ça s’est transformé en une espèce de menace psychiatrique : si tu n’es pas comme tout le monde, c’est que tu es anormal, si tu es anormal, c’est que tu es malade. Ces trois catégories : n’être pas comme tout le monde, n’être pas normal et être malade, sont tout de même très différentes et se sont trouvées assimilées les unes aux autres. Mais je n’ai pas envie de faire mon autobiographie. Ce n’est pas intéressant.
Pourquoi ?
Je ne veux pas de ce qui pourrait donner l’impression de rassembler ce que j’ai fait en une espèce d’unité qui me caractériserait et me justifierait, en donnant sa place à chacun des textes. Jouons plutôt, si vous voulez, au jeu des énoncés : ils viennent comme ça, on repoussera les uns, on acceptera les autres. Je crois qu’on devrait lancer une question comme on lance une bille au flipper : elle fait tilt ou elle ne fait pas tilt, et puis on la relance, et de nouveau on voit…
La bille ricoche donc. Ce qui vous intéressait, c’étaient déjà les relations entre savoir et pouvoir ?
Je trouvais surtout paradoxal de poser le problème du fonctionnement politique du savoir à partir de sciences si hautement élaborées que les mathématiques, la physique et la biologie. On ne posait le problème du fonctionnement historique du savoir qu’à partir de ces grandes sciences nobles. Or j’avais sous les yeux, avec la psychiatrie, de légères pellicules de savoir à peine formées qui étaient absolument liées à des formes de pouvoir que l’on pouvait analyser.
Au fond, au lieu de poser le problème de l’histoire des mathématiques, comme l’avait fait Tran Duc Thao, ou comme le faisait Jean-Toussaint Desanti, au lieu de poser le problème de l’histoire de la physique ou de la biologie, je me disais qu’il fallait prendre des sciences à peine formées, contemporaines, avec un matériau riche, puisque précisément elles nous sont contemporaines, et tenter de comprendre quels sont leurs effets de pouvoir. C’est finalement cela que j’ai voulu faire dans Histoire de la folie : reprendre un problème qui était celui des marxistes, la formation d’une science à l’intérieur d’une société donnée.
Pourtant, les marxistes ne posaient pas du tout, à cette époque, le problème de la folie, ou celui de l’institution psychiatrique…
J’ai même compris plus tard que ces problèmes étaient jugés dangereux, à plus d’un égard, du côté des marxistes. C’était d’abord violer la grande loi de la dignité des sciences, cette hiérarchie encore positiviste, héritée d’Auguste Comte, qui place en premier les mathématiques, puis l’astronomie, etc. S’occuper de ces sciences moches, un peu visqueuses, que sont la psychiatrie ou la psychologie, ce n’était pas bien !
Surtout, en faisant l’histoire de la psychiatrie, en tentant d’analyser son fonctionnement historique dans une société, je mettais le doigt, absolument sans le savoir, sur le fonctionnement de la psychiatrie en Union soviétique. Je n’avais pas en tête le lien des partis communistes à toutes les techniques de surveillance, de contrôle social, de repérage des anomalies.
C’est pourquoi, d’ailleurs, s’il y a eu beaucoup de psychiatres marxistes, dont certains étaient ouverts et intelligents, ils n’ont pas inventé l’antipsychiatrie. Ce sont des Anglais un peu mystiques qui ont fait ce travail. Les psychiatres marxistes français faisaient fonctionner la machine. Ils ont sans doute mis en question un certain nombre de choses, mais, dans l’histoire du mouvement antipsychiatrique, leur rôle est tout de même relativement limité.
Vous voulez dire à cause de leur lien profond à un certain maintien de l’ordre ?
Oui. Un communiste, en 1960, ne pouvait pas dire qu’un homosexuel n’est pas un malade. Il ne pouvait pas dire non plus : la psychiatrie est liée, dans tous les cas, de bout en bout, à des mécanismes de pouvoir qu’il faut critiquer.
Les marxistes ont donc réservé un mauvais accueil à ce livre…
En fait, ce fut un silence total. Il n’y a pas eu un seul marxiste pour réagir à ce livre, ni en pour ni en contre. Pourtant, ce bouquin s’adressait d’abord à ces gens qui se posaient le problème du fonctionnement de la science. On peut se demander, rétrospectivement, si leur silence n’était pas lié au fait qu’en toute innocence, donc en toute bêtise, j’avais soulevé un lièvre qui les embarrassait.
Il existait encore une raison plus évidente et simple au désintérêt des marxistes, c’est que je ne me servais pas de Marx, explicitement et massivement, pour conduire l’analyse. Pourtant, à mon sens, l’Histoire de la folie est au moins aussi marxiste que bien des histoires des sciences écrites par des marxistes.
Plus tard, vers les années 1965-1968, au moment où le retour à Marx produisait les effets non seulement théoriques, mais aussi pratiques que vous connaissez bien, c’était dur de n’être pas marxiste, c’était dur d’avoir écrit tant de pages sans qu’il y ait, à un seul endroit, la petite phrase élogieuse sur Marx à laquelle on aurait pu se raccrocher… Hélas, j’avais écrit trois petites phrases sur Marx qui étaient détestables ! Alors, ce fut la solitude, et aussi les injures…
Vous avez éprouvé à ce moment le sentiment d’être seul ?
Je l’ai ressenti bien avant, en particulier après la publication de l’ Histoire de la folie . Entre le moment où j’ai commencé à poser ce type de problème concernant la psychiatrie et ses effets de pouvoir et le moment où ces questions ont commencé à rencontrer un écho concret et réel dans la société, il s’est écoulé des années. J’avais l’impression d’avoir allumé la mèche, et puis on n’avait rien entendu. Comme dans un cartoon, je pianotais en attendant la détonation, et la détonation ne venait pas !
Vous imaginiez véritablement votre livre comme une bombe ?
Absolument ! J’envisageais ce livre comme une espèce de souffle vraiment matériel, et je continue à le rêver comme ça, une espèce de souffle faisant éclater des portes et des fenêtres… Mon rêve, ce serait un explosif efficace comme une bombe et joli comme un feu d’artifice.
Et votre Histoire de la folie a bien été perçue très vite comme un feu d’artifice, mais avant tout littéraire. Cela vous a déconcerté ?
C’était une sorte de chassé-croisé : je m’étais adressé plutôt à des politiques, et je n’ai été d’abord entendu que par des gens qui étaient considérés comme des littéraires, en particulier Blanchot et Barthes. Mais il est vraisemblable qu’ils avaient, à partir même de leur expérience littéraire, une sensibilité à un certain nombre de problèmes que les politiques, eux, n’avaient pas. Qu’ils aient réagi me paraît finalement être le signe qu’ils étaient, à l’intérieur même de leur pratique essentiellement littéraire, plus profondément politiques que ceux qui avaient le discours marxiste pour coder leur politique.
J’en reviens aux histoires biographiques ! Heureusement, elles touchent un peu plus que ma biographie. Quand j’ai vu des gens que j’admirais beaucoup, comme Blanchot et Barthes, porter de l’intérêt à mon livre, j’ai éprouvé à la fois de l’émerveillement et un peu de honte, comme si, sans le vouloir, je les avais dupés. Car ce que je faisais était pour moi tout à fait étranger au champ de la littérature. Mon travail était directement lié à la forme des portes dans les asiles, à l’existence des serrures, etc. Mon discours était lié à cette matérialité-là, à ces espaces clos, et je voulais que les mots que j’avais écrits traversent des murs, fassent sauter des serrures, ouvrent des fenêtres !
Vous dites cela en riant…
Il faut bien y mettre un peu d’ironie… Ce qui est ennuyeux, dans les interviews, c’est que le rire ne passe pas !
Rien n’interdit de l’indiquer !
Evidemment, mais quand on met entre parenthèses rire , vous savez bien que ça ne donne pas cette sonorité d’une phrase qui se perd en rire…
Revenons sur la question de l’écriture. Vous dites qu’ Histoire de la folie n’est pas une oeuvre littéraire à vos yeux. Pourtant, son écriture et son style ont été tout de suite remarqués. Cela vaut aussi pour vos autres livres. On vous lit pour la nouveauté et l’acuité des analyses, mais aussi par plaisir. Il y a un style Michel Foucault, des effets de plume presque à chaque page. Ce n’est tout de même pas un hasard. Pourquoi dites-vous que vous n’êtes pas un écrivain ?
C’est très simple. Je crois qu’il faut avoir une conscience artisanale dans ce domaine. De même qu’il faut bien faire un sabot, il faut bien faire un livre. Cela vaut d’ailleurs pour n’importe quel paquet de phrases imprimées, que ce soit dans un journal ou une revue. Pour moi, l’écriture n’est rien d’autre que cela. Elle doit servir au livre. Ce n’est pas le livre qui sert cette grande entité, si sacralisée maintenant, que serait l’écriture .
Vous me dites que j’emploie souvent un certain nombre de contorsions stylistiques qui semblent prouver que j’aime bien le beau style. Eh bien, oui, il y a toujours une espèce de plaisir, bassement érotique peut-être, à trouver une jolie phrase, quand on s’ennuie, un matin, à écrire des choses pas très drôles. On s’excite un peu, en rêvassant, et brusquement on trouve la jolie phrase qu’on attendait. ça fait plaisir, ça donne un élan pour aller plus loin. Il y a de cela, évidemment.
Mais il y a aussi le fait que, si on veut qu’il devienne un instrument dont d’autres pourront se servir, il faut que le livre fasse plaisir à ceux qui le lisent. ça me paraît être le devoir élémentaire de celui qui livre cette marchandise ou cet objet artisanal : il faut que ça puisse faire plaisir !
Double plaisir, donc : de l’auteur, du lecteur…
Absolument. Que des trouvailles ou des astuces de style fassent plaisir à celui qui écrit, et à celui qui lit, je trouve ça très bien. Il n’y a aucune raison que je me refuse ce plaisir, de même qu’il n’y a pas de raison que j’impose de s’ennuyer à des gens dont je souhaite qu’ils lisent mon livre. Il s’agit de parvenir à quelque chose d’absolument transparent au niveau de ce qui est dit, avec tout de même une espèce de surface de chatoiement qui fasse qu’on ait plaisir à caresser le texte, à l’utiliser, à y repenser, à le reprendre. C’est ma morale du livre.
Mais ce n’est pas, encore une fois, de l’écriture . Je n’aime pas l’écriture. Etre écrivain me paraît véritablement dérisoire. Si j’avais à me définir, à donner de moi une définition prétentieuse, si j’avais à décrire cette espèce d’image qu’on a à côté de soi, qui à la fois ricane et puis vous guide malgré tout, alors je dirais que je suis un artisan, et aussi, je le répète, une sorte d’artificier. Je considère mes livres comme des mines, des paquets d’explosifs… Ce que j’espère qu’ils sont !
Dans mon esprit, ces livres ont à produire un certain effet, et pour cela il faut mettre le paquet, pour parler vulgairement. Mais le livre doit disparaître par son effet même, et dans son effet même. L’écriture n’est qu’un moyen, ce n’est pas le but. L’oeuvre n’est pas le but non plus ! De sorte que remanier un de mes livres pour l’intégrer à l’unité d’une oeuvre, pour qu’il me ressemble ou pour qu’il ressemble aux livres qui viendront ensuite, ça n’a pour moi aucun sens.
Vous refusez d’être un auteur ?
Dès que vous écrivez, même si c’est sous votre nom d’état civil, vous vous mettez à fonctionner comme quelqu’un d’un peu autre, un écrivain . Vous établissez, de vous-même à vous-même, des continuités et un niveau de cohérence qui ne sont pas exactement ceux de votre vie réelle. Un bouquin de vous renvoie à un autre bouquin de vous, une déclaration de vous renvoie à tel geste public de vous… Tout cela finit par constituer une sorte de néo-identité qui n’est pas identique à votre identité d’état civil, ni même à votre identité sociale. D’ailleurs, vous le savez très bien, puisque vous voulez protéger votre vie dite privée.
Vous n’admettez pas que votre vie d’écrivain ou votre vie publique interfère totalement avec votre vie privée. Vous établissez entre vous, écrivain, et les autres écrivains, ceux qui vous ont précédé, ceux qui vous entourent ou qui vous suivront, des liens d’affinités, de parenté, de cousinage, d’ascendance, de descendance qui ne sont pas ceux de votre famille réelle.
Ce n’est pas ainsi que je vois mon travail. J’imaginerai plutôt mes livres comme des billes qui roulent. Vous les captez, vous les prenez, vous les relancez. Et si ça marche, tant mieux. Mais ne me demandez pas qui je suis avant d’utiliser mes billes pour savoir si elles ne vont pas être empoisonnées, ou si elles ne sont pas bien sphériques, ou si elles ne vont pas dans le bon sens. En tout cas, ce n’est pas parce que vous m’aurez demandé mon identité que vous saurez si ce que je fais est utilisable.
Ecrire n’est-il pas pour vous, malgré tout, une nécessité ?
Non, non, ce n’est absolument pas une nécessité. Je n’ai jamais considéré que c’était un honneur que d’écrire ou un privilège, ou quoi que ce soit d’extraordinaire. Je dis souvent : ah, quand viendra le jour où je n’écrirai plus ! Ce n’est pas le rêve d’aller au désert, ou simplement à la plage, mais de faire autre chose que d’écrire. Je le dis aussi en un sens plus précis, qui est : quand est-ce que je me mettrai à écrire sans qu’écrire soit de l’écriture ? Sans cette espèce de solennité qui sent l’huile.
Les choses que je publie, elles sont écrites, au mauvais sens du terme : ça sent l’écriture . Et quand je me mets au travail, c’est de l’écriture , ça implique tout un rituel, toute une difficulté. Je me mets dans un tunnel, je ne veux voir personne, alors que j’aimerais au contraire avoir une écriture facile, de premier jet. Et ça, je n’y arrive absolument pas. Et il faut le dire, parce que ce n’est pas la peine de tenir de grands discours contre l’écriture si on ne sait pas que j’ai tant de mal à ne pas écrire quand je me mets à écrire. Je voudrais échapper à cette activité enfermée, solennelle, repliée sur soi qui est pour moi l’activité de mettre des mots sur le papier
Vous prenez pourtant, à ce travail du papier et de l’encre, un réel plaisir ?
Le plaisir que j’y prends est tout de même très opposé à ce que je voudrais que soit l’écriture. J’aimerais que ce soit un truc qui passe, qu’on jette comme ça, qu’on écrit sur un coin de table, qu’on donne, qui circule, qui aurait pu être un tract, une affiche, un fragment de film, un discours public, n’importe quoi… Encore une fois, je n’arrive pas à écrire ainsi. Bien sûr, j’y ai mon plaisir, je découvre des petits trucs, mais je n’ai pas plaisir à prendre ce plaisir.
J’éprouve à son égard un sentiment de malaise, parce que je rêverais d’un tout autre plaisir que celui, bien familier, de tous les gens qui écrivent. On s’enferme, le papier est blanc, on n’a aucune idée, et puis, petit à petit, au bout de deux heures, ou de deux jours, ou de deux semaines, à l’intérieur même de l’activité d’écrire, un tas de choses sont devenues présentes. Le texte existe, on en sait beaucoup plus qu’avant. On avait la tête vide, on l’a pleine, car l’écriture ne vide pas, elle remplit. De son propre vide on fait une pléthore. Tout le monde connaît ça. ça ne m’amuse pas !
Alors vous rêveriez de quoi ? De quelle autre écriture ?
Une écriture discontinue, qui ne s’apercevrait pas qu’elle est une écriture, qui se servirait du papier blanc, ou de la machine, ou du porte-plume, ou du clavier, comme ça, au milieu de tas d’autres choses qui pourraient être le pinceau ou la caméra. Tout ça passant très rapidement de l’un à l’autre, une sorte de fébrilité et de chaos
Vous avez envie d’essayer ?
Oui, mais il me manque cette espèce de je-ne-sais-quoi de fébrilité ou de talent, les deux sans doute. Finalement, je suis toujours renvoyé à l’écriture. Alors je rêve de textes brefs. Mais ça donne toujours de gros livres ! Malgré tout, je rêve toujours d’écrire un genre de livre tel que la question : D’où ça vient ? n’ait pas de sens. Je rêve d’une pensée vraiment instrumentale. Peu importe d’où elle vient. ça tombe comme ça. L’essentiel, c’est qu’on ait entre les mains un instrument avec lequel on va pouvoir aborder la psychiatrie, ou le problème des prisons.
Vous n’aimez guère qu’on vous demande vos justifications, les raisons de votre légitimité. Pourquoi ?
Quand je suis rentré de Tunisie, l’hiver 68-69, à l’université de Vincennes il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu’un vous demande : D’où tu parles ? Cette question me mettait toujours dans un grand abattement. ça me paraissait une question policière, au fond. Sous l’apparence d’une question théorique et politique ( D’où parles-tu ? ), en fait, on me posait une question d’identité ( Au fond, qui es-tu ? , Dis-nous donc si tu es marxiste ou si tu n’es pas marxiste , Dis-nous si tu es idéaliste ou matérialiste , Dis-nous si tu es prof ou militant , Montre ta carte d’identité, dis au nom de quoi tu vas pouvoir circuler d’une manière telle qu’on reconnaîtra où tu es ).
ça me paraît finalement une question de discipline. Et je ne peux pas m’empêcher de rabattre ces graves interrogations sur la justification du fondement à la vilaine petite question : Qui es-tu, où es-tu né ? A quelle famille appartiens-tu ? Ou encore : Quelle est ta profession ? Comment est-ce qu’on peut te classer ? Où dois-tu faire ton service militaire ?
Voilà ce que j’entends, chaque fois qu’on demande : De quelle théorie te sers-tu ? Qu’est-ce qui t’abrite ? Qu’est-ce qui te justifie ? J’entends des questions policières et menaçantes : Aux yeux de qui seras-tu innocent, même si tu dois être condamné ? Ou bien : Il doit bien y avoir un groupe de gens, ou une société ou une forme de pensée, qui t’absoudra, et dont tu pourras obtenir la relaxe. Et si ceux-là t’absolvent, c’est que nous devons te condamner !
Qu’est-ce qui vous semble tellement à fuir dans ces demandes d’identité ?
Je crois que l’identité est un des produits premiers du pouvoir, de ce type de pouvoir que nous connaissons dans notre société. Je crois beaucoup, en effet, à l’importance constitutive des formes juridico-politico-policières de notre société. Est-ce que le sujet, identique à lui-même, avec son historicité propre, sa genèse, ses continuités, les effets de son enfance prolongés jusqu’au dernier jour de sa vie, etc., n’est pas le produit d’un certain type de pouvoir qui s’exerce sur nous, dans les formes juridiques anciennes et dans les formes policières récentes ?
Il faut rappeler que le pouvoir n’est pas un ensemble de mécanismes de négation, de refus, d’exclusion. Mais il produit effectivement. Il produit vraisemblablement jusqu’aux individus eux-mêmes. L’individualité, l’identité individuelle sont des produits du pouvoir. C’est pour cela que je m’en méfie, et que je m’efforce de défaire ces pièges.
La seule vérité de l’ Histoire de la folie , ou de Surveiller et punir , c’est qu’il y ait des gens qui s’en servent, et se battent avec. C’est la seule vérité que je cherche. La question D’où est-ce que ça vient ? est-ce que c’est marxiste ? me paraît finalement une question d’identité, donc une question policière.
Je vais donc être policier, car j’aimerais quand même revenir un moment en arrière, comprendre d’où est venu votre itinéraire. Durant vos années d’Ecole normale, vous étiez marxiste ?
Comme presque tous ceux de ma génération, j’étais entre le marxisme et la phénoménologie, moins celle que Sartre ou Merleau-Ponty ont pu connaître et utiliser que la phénoménologie présente dans ce texte de Husserl de 1935-1937, La crise des sciences européennes , la Krisis , comme nous disions. Ce qu’il mettait en question, c’était tout le système de savoir dont l’Europe avait été le foyer, le principe, le moteur, et par lequel elle avait été aussi bien affranchie qu’emprisonnée. Pour nous, quelques années après la guerre et tout ce qui s’était passé, cette interrogation reparaissait dans sa vivacité. La Krisis, c’était pour nous le texte qui signalait, dans une philosophie très hautaine, très académique, très fermée sur elle-même malgré son projet de description universelle, l’irruption d’une histoire toute contemporaine. Quelque chose était en train de craquer, autour de Husserl, autour de ce discours que l’Université allemande tenait à bout de bras, depuis tant d’années. Ce craquement, on l’entendait brusquement dans le discours du philosophe. On se demandait enfin ce qu’étaient ce savoir et cette rationalité, si profondément liés à notre destin, profondément liés à tant de pouvoirs, et si impuissants devant l’Histoire.
Et les sciences humaines étaient évidemment des objets qui se trouvaient mis en question par cette démarche. Mes premiers balbutiements étaient donc cela : qu’est-ce que les sciences humaines ? A partir de quoi sont-elles possibles ? Comment est-on arrivé à construire de pareils discours et à se donner de pareils objets ? Je reprenais ces interrogations, mais en essayant de me débarrasser du cadre philosophique de Husserl.
On assistait en même temps à la lente montée du marxisme à l’intérieur d’une pratique qu’on peut dire traditionnelle et universitaire de la philosophie. Pour les générations d’avant-guerre, le marxisme représentait presque toujours une alternative au travail universitaire. Lucien Herr, grande figure historique, était un bibliothécaire impavide à l’Ecole normale et, le soir, la bibliothèque soigneusement bouclée, il descendait animer des réunions socialistes sans qu’en principe personne ne le sache.
Cette situation était différente au temps de vos études ?
Oui, après la guerre, le marxisme entrait dans l’université. A un moment, on a pu citer Marx dans les copies d’agrégation. Cela correspondait à la stratégie du Parti envers les appareils d’Etat. Je me souviens parfaitement qu’Althusser m’avait envoyé gentiment faire des cours de philosophie et de philosophie politique aux candidats à l’ENA de la CGT ! En fait, cette entrée du Parti communiste dans l’appareil d’Etat n’a réussi pleinement que dans l’université.
Cette acceptation du marxisme dans l’université et l’acceptation par le Parti communiste de pratiques universitaires normalement reconnues ont créé pour nous une situation d’une grande facilité. Devenir agrégé de philo en parlant de Marx, comme les choses étaient simples ! Alors nous livrions de pseudo-luttes : pour le droit de citer Engels aussi bien que Marx, pour que le président du jury d’agrégation accepte qu’on parle de Lénine. C’étaient nos petits combats, on les croyait très importants.
Seulement, à mesure qu’on entrait dans cette union de l’université et du Parti communiste, on découvrait avec horreur leur similitude : les mêmes hiérarchies, les mêmes contraintes, les mêmes orthodoxies. On ne pouvait pas faire plus proche de l’université que la structure du Parti, du moins dans ses basses sphères qui concernaient les intellectuels. Rédiger une dissertation pour un président de jury d’agrégation, ou écrire, comme ça m’est arrivé, des articles que signait un dirigeant du Parti, c’était exactement le même exercice !
C’est là qu’a commencé pour moi une forme d’étouffement qui était dû à la facilité même de ces opérations. On croyait que ça allait être la lutte, et tout baignait dans l’huile. Ce qui m’avait intéressé et stimulé, c’était ce mirage de la lutte qu’on nous avait fait miroiter. Nous devions être les soldats avancés de la mise de l’université à la disposition du peuple, ou de l’avant-garde du prolétariat ! Et nous nous retrouvions entre nous, toujours les mêmes. Alors, je suis parti pour la Suède, puis pour la Pologne.
C’est en Pologne que vous avez cessé d’être marxiste ?
Oui, parce que là j’ai vu fonctionner un Parti communiste au pouvoir, contrôlant un appareil d’Etat, s’identifiant avec lui. Ce que j’avais senti obscurément pendant la période 50-55 apparaissait dans sa vérité brutale, historique, profonde. Ce n’étaient plus des imaginations d’étudiant, des jeux à l’intérieur de l’université. C’était le sérieux d’un pays asservi par un parti.
Depuis ce moment-là, je peux dire que je ne suis pas marxiste, au sens où je ne peux pas accepter le fonctionnement des partis communistes tels qu’on nous les propose en Europe de l’Est comme en Europe de l’Ouest. S’il y a chez Marx des choses vraies, on peut les utiliser comme instruments sans avoir à les citer, les reconnaîtra qui veut bien ! Ou qui en est capable…
Y a-t-il d’autres moments où le fait de vivre à l’étranger ait contribué à l’élaboration de votre pensée ?
Oui, la Tunisie a été pour moi, entre 1966 et 1968, le symétrique de l’expérience polonaise. Ma société, je ne la connaissais que sous l’angle d’un privilégié. Je n’avais jamais eu beaucoup de problèmes, ni politiques ni économiques, dans mon existence. Et je n’avais perçu ce que pouvait être une oppression qu’en Pologne, c’est-à-dire dans un Etat socialiste. De la société capitaliste je n’avais connu finalement que le côté velouté et facile. En Tunisie, j’ai découvert ce que pouvaient être les restes d’une colonisation capitaliste, et la naissance d’un développement de type capitaliste avec tous les phénomènes d’exploitation et d’oppression économiques et politiques.
Deux mois avant Mai 68, j’ai vu en Tunisie une grève étudiante qui a littéralement baigné dans le sang à l’université. Les étudiants étaient conduits au sous-sol, où il y avait une cafétéria, et remontaient le visage en sang parce qu’ils avaient été matraqués. Il y a eu des centaines d’arrestations. Plusieurs de mes étudiants ont été condamnés à dix, douze, quatorze ans de prison. Ce fut pour moi un mois de mai sans doute plus sérieux que celui que j’aurais connu en France.
La double expérience Pologne-Tunisie équilibrait mon expérience politique et me renvoyait à des choses qu’au fond je n’avais pas suffisamment soupçonnées dans mes pures spéculations : l’importance de l’exercice du pouvoir, ces lignes de contact entre le corps, la vie, le discours et le pouvoir politique.
Dans les silences et les gestes quotidiens d’un Polonais qui se sait surveillé, qui attend d’être dans la rue pour vous dire quelque chose, parce qu’il sait bien que dans l’appartement d’un étranger il y a des micros partout, dans la façon dont on baisse la voix quand on est dans un restaurant, dans la manière dont on brûle une lettre, enfin dans tous ces petits gestes étouffants, aussi bien que dans la violence crue et sauvage de la police tunisienne s’abattant sur une faculté, j’ai traversé une sorte d’expérience physique du pouvoir, des rapports entre corps et pouvoir.
Ensuite, ces moments-là m’ont considérablement obsédé, même si je n’en ai tiré la leçon théorique que très tardivement. Je me suis aperçu que j’aurais dû parler depuis longtemps de ces problèmes de rapport entre le pouvoir et le corps à quoi j’ai abouti, finalement, dans Surveiller et punir .
Pourtant, pour beaucoup de gens, Mai 68 a constitué aussi une expérience de la violence physique du pouvoir et de son rapport au corps. Même avec quelque retard, vous ne l’avez pas perçu ?
Je suis rentré en France en novembre 1968. J’ai eu l’impression que toute cette expérience avait tout de même été profondément engagée et codée par un discours marxiste auquel très peu échappaient. Au contraire, aussi bien en Tunisie qu’en Pologne, cette expérience m’était apparue indépendamment de tout codage par le discours marxiste. S’il y avait discours marxiste en Pologne, il était du côté du pouvoir, du côté de la violence.
Dans les années d’après-Mai, ceux qui se disaient révolutionnaires sans se référer explicitement au marxisme conservaient tout de même une très forte adhérence à la plupart des analyses marxistes. Et lorsqu’ils intervenaient, lorsqu’ils posaient des questions, lorsqu’ils discutaient avec vous, les effets de pouvoir étaient toujours liés au marxisme. A Vincennes, durant l’hiver 1968-1969, dire à haute et intelligible voix : Je ne suis pas marxiste , c’était physiquement très difficile… Ce qui m’a frappé à Vincennes, dans les AG et les machins comme ça auxquels j’ai assisté, c’est l’incroyable proximité entre ce qui s’y passait et ce que j’avais entendu et vu au PC, dans sa période la plus stalinienne. Bien sûr, toutes les formes étaient changées, les rituels étaient différents. Mais les effets de pouvoir, les terreurs, les prestiges, les hiérarchies, les obéissances, les veuleries, les petites ignominies, etc., c’était la même chose. C’était un stalinisme explosé, en ébullition, mais c’était toujours lui… Et je me disais : comme ils ont peu changé !
Revenons à votre parcours…
Vous savez, ce parcours a été zigzagant. Les mots et les choses est un livre qui est d’une certaine façon marginal, tout en prenant les autres en fourchette. Il est marginal parce qu’il n’était pas du tout dans le droit-fil de mon problème. En étudiant l’histoire de la folie, je m’étais naturellement posé le problème du fonctionnement du savoir médical à l’intérieur duquel s’étaient trouvés délimités les rapports du fou et du non-fou, à partir du XIXe siècle.
Et puis le savoir médical conduisait au problème de cette très rapide évolution qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et qui a fait apparaître non seulement la psychiatrie et la psychopathologie, mais aussi la biologie et les sciences humaines. C’était le passage d’un certain type d’empiricité à un autre. Prenez n’importe quel bouquin de médecine de 1780 et n’importe quel bouquin de 1820 : on est passé d’un monde à un autre… il faut vraiment avoir très peu lu ce genre d’ouvrage, que ce soit de grammaire, de médecine ou d’économie politique, pour imaginer que je délire quand je parle d’une coupure à la fin du XVIIIe siècle !
Au fond, Les mots et les choses ne fait que constater cette coupure, essaie d’en dresser le bilan dans un certain nombre de discours, essentiellement ceux qui tournent autour de l’homme, du travail, de la ville, du langage…. Cette coupure, c’est mon problème, ce n’est pas ma solution. Si j’insiste tellement sur cette coupure, c’est que c’est un sacré casse-tête, et pas du tout une manière de résoudre les choses.
Comment expliquer cette coupure ? A quoi correspond-elle ?
En fait, j’ai mis sept ans avant de m’apercevoir que la solution n’était pas à chercher où je la cherchais, dans quelque chose du genre l’idéologie, le progrès de la rationalité ou le mode de production. C’était finalement dans les technologies de pouvoir et dans leurs transformations, depuis le XVIIe siècle jusqu’à maintenant, qu’il fallait voir le socle à partir duquel le changement était possible. Les mots et les choses se situait au niveau du constat de la coupure et de la nécessité d’aller chercher une explication. Surveiller et punir , c’est la généalogie, si vous voulez, l’analyse des conditions historiques qui ont rendu possible cette coupure.
J’ai commencé à comprendre comment on avait bâi non seulement le personnage du fou, mais le personnage de l’homme normal, à travers toute une certaine anthropologie de la raison et de la déraison. Il m’est apparu, à travers ces enquêtes, que la position centrale de l’homme était finalement une figure propre au discours scientifique, ou au discours des sciences humaines, ou au discours philosophique du XIXe siècle. Tout centrer sur la figure de l’homme, ce n’est pas une ligne de pente du discours philosophique depuis son origine, c’est une flexion récente dont on peut parfaitement repérer l’origine et dont on peut voir aussi comment elle est en train de disparaître, vraisemblablement depuis la fin du XIXe.
La découverte de cette coupure, l’accent mis sur les effets de pouvoir des différents savoirs, acceptez-vous de dire que c’est votre découverte, votre apport personnel ?
Absolument pas ! C’est dans le droit-fil de tout un ensemble, que ce soit La généalogie de la morale de Nietzsche ou la Krisis de Husserl. L’histoire du pouvoir de la vérité dans une société comme la nôtre, cette question, elle tourne sans arrêt dans les têtes depuis une centaine d’années. Je n’ai fait que l’aborder à ma façon, et j’ai énoncé dans L’archéologie du savoir quelques règles que je me suis données. Elles n’ont rien de bouleversant ni de révolutionnaire, mais, puisque les gens ne semblaient pas bien comprendre ce que je faisais, j’ai donné mes règles.
Je ne suis pas de ces veilleurs qui affirment toujours être le premier à avoir vu le jour se lever. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre en quoi consiste ce seuil de modernité que l’on peut repérer entre le XVIIe et le XIXe siècle. A partir de ce seuil, le discours européen a développé des pouvoirs d’universalisation gigantesques. Aujourd’hui, dans ses notions fondamentales et ses règles essentielles, il peut être porteur de n’importe quel type de vérité, même si cette vérité doit être retournée contre l’Europe, contre l’Occident.
Au fond, je n’ai qu’un seul objet d’étude historique, c’est le seuil de la modernité. Qui sommes-nous, nous qui parlons ce langage tel qu’il a des pouvoirs qui s’imposent à nous-mêmes dans notre société, et à d’autres sociétés ? Quel est ce langage que l’on peut retourner contre nous, que nous pouvons retourner contre nous-mêmes ? Quel est cet emballement formidable du passage à l’universalité du discours occidental ? Voilà mon problème historique.
Une façon différente de concevoir la relation entre savoir et pouvoir ?
Le savoir, pendant des siècles, disons depuis Platon, s’est donné comme statut d’être d’une essence fondamentalement différente du pouvoir. Si tu deviens roi, tu seras fou, passionné et aveugle. Renonce au pouvoir, renonce à l’ambition, renonce à vaincre, alors tu pourras contempler la vérité. Il y a eu un fonctionnement très ancien de tout le système de savoir dans son opposition ou son indépendance à l’égard du pouvoir. A présent, au contraire, ce qu’on interroge, c’est la position des intellectuels et des savants dans la société, dans les systèmes de production, dans les systèmes politiques. Le savoir apparaît lié en profondeur à toute une série d’effets de pouvoir. L’archéologie, c’est essentiellement cette détection.
Le type de discours qui fonctionne en Occident, depuis un certain nombre de siècles, comme discours de vérité, et qui est passé maintenant à l’échelle mondiale, ce type de discours est lié à toute une série de phénomènes de pouvoir et de relations de pouvoir. La vérité a du pouvoir. Elle possède des effets pratiques, des effets politiques. L’exclusion du fou, par exemple, est un des innombrables effets de pouvoir du discours rationnel. Comment ces effets de pouvoir opèrent-ils ? Comment deviennent-ils possibles ? Voilà ce que j’essaie de comprendre.
Une société sans pouvoir est-elle possible ? C’est une question qui a du sens ou qui n’en a pas ?
Je crois qu’il n’y a pas à poser le problème en termes faut-il du pouvoir ou n’en faut-il pas ? . Le pouvoir va si loin, il s’enfonce si profondément, il est véhiculé par un réseau capillaire si serré qu’on se demande où il n’y en aurait pas. Pourtant, son analyse a été très négligée par les études historiques. La seconde moitié du XIXe siècle a découvert les mécanismes de l’exploitation, peut-être la tâhe de la seconde moitié du XXe siècle est-elle de découvrir les mécanismes du pouvoir. Car nous sommes tous non seulement la cible d’un pouvoir, mais aussi le relais, ou le point d’où émane un certain pouvoir !
Ce qu’il y a à découvrir en nous, ce n’est pas ce qui est aliéné, ou ce qui est inconscient. Ce sont ces petites valves, ces petits relais, ces minuscules engrenages, ces microscopiques synapses par lesquels le pouvoir passe et se trouve reconduit par lui-même.
Dans cette perspective, reste-t-il quelque chose qui échapperait au pouvoir ?
Ce qui échappe au pouvoir, c’est le contre-pouvoir, qui est pourtant pris lui aussi dans le même jeu. C’est pourquoi il faut reprendre le problème de la guerre, de l’affrontement. Il faut reprendre les analyses tactiques et stratégiques à un niveau extraordinairement bas, infime, quotidien. Il faut repenser l’universelle bataille en échappant aux perspectives de l’Apocalypse. En effet, on a vécu depuis le XIXe siècle dans une économie de pensée qui était apocalyptique. Hegel, Marx ou Nietzsche, ou Heidegger dans un autre sens, nous ont promis le lendemain, l’aube, l’aurore, le jour qui pointe, le soir, la nuit, etc. Cette temporalité, à la fois cyclique et binaire, commandait notre pensée politique et nous laisse désarmés quand il s’agit de penser autrement.
Est-il possible d’avoir une pensée politique qui ne soit pas de l’ordre de la description triste : voilà comment c’est, et vous voyez que ce n’est pas drôle ! Le pessimisme de droite consiste à dire : regardez comme les hommes sont salauds. Le pessimisme de gauche dit : regardez comme le pouvoir est dégueulasse ! Pouvons-nous échapper à ces pessimismes sans tomber dans la promesse révolutionnaire, dans l’annonciation du soir ou du matin ? Je crois que c’est ça, l’enjeu, actuellement.
Ce qui conduit à votre conception de l’Histoire. Sartre disait : Foucault n’a pas le sens de l’Histoire ...
C’est une phrase qui m’enchante ! Je voudrais qu’on la mette en exergue de tout ce que je fais, car je crois qu’elle est profondément vraie. Si avoir le sens de l’Histoire, c’est lire avec une attention respectueuse les ouvrages des grands historiens, les doubler sur leur aile droite d’un rien de phénoménologie existentielle, sur la gauche d’un zeste de matérialisme historique, si avoir le sens de l’Histoire, c’est prendre l’Histoire toute faite, acceptée dans l’université, en ajoutant seulement que c’est une Histoire bourgeoise qui ne tient pas compte de l’apport marxiste, eh bien, il est vrai que je n’ai absolument pas le sens de l’Histoire ! Sartre a peut-être le sens de l’Histoire, mais il n’en fait pas. Qu’a-t-il apporté à l’Histoire ? Zéro !
Je pense qu’il voulait dire autre chose, malgré tout. Il voulait dire que je ne respecte pas cette signification de l’Histoire admise dans toute une philosophie post-hégélienne, dans laquelle sont impliqués des processus qui doivent être toujours les mêmes ; exemple, la lutte des classes… Deuxièmement, avoir le sens de l’Histoire, dans cette forme-là d’histoire, c’est être toujours capable d’opérer une totalisation, au niveau d’une société, ou d’une culture, ou d’une conscience, peu importe. Une étude historique est achevée, dans cette optique, quand ce processus vient s’inscrire dans une conscience qui en dégage la signification dans le mouvement même par laquelle elle est déterminée… Il est vrai que de cette Histoire-là je n’ai absolument pas le sens !
Comment définiriez-vous l’Histoire, vous ?
J’en fais un usage rigoureusement instrumental. C’est à partir d’une question précise que je rencontre dans l’actualité que la possibilité d’une histoire se dessine pour moi. Mais l’utilisation académique de l’Histoire est essentiellement une utilisation conservatrice : retrouver le passé de quelque chose a essentiellement pour fonction de permettre sa survie. L’histoire de l’asile, par exemple, telle qu’on l’a faite souvent, d’ailleurs - je ne suis pas le premier -, était essentiellement destinée à en montrer l’espèce de nécessité, de fatalité historique.
Ce que je tente de faire, c’est au contraire de montrer l’impossibilité de la chose, la formidable impossibilité sur quoi repose le fonctionnement de l’asile, par exemple. Les histoires que je fais ne sont pas explicatives, elles ne montrent jamais la nécessité de quelque chose, mais plutôt la série des enclenchements par lesquels l’impossible s’est produit et reconduit son propre scandale, son propre paradoxe, jusqu’à maintenant. Tout ce qu’il peut y avoir d’irrégulier, de hasardeux, d’imprévisible dans un processus historique m’intéresse considérablement.
D’habitude, les historiens écartent ce qui relève de l’exception…
Parce qu’une des tâhes de l’Histoire, qui a pour fonction de conserver les choses, est justement de gommer ces espèces d’irrégularités ou de hasards, ces événements en dents de scie. On gomme tout cela pour rester dans une forme de nécessité qui, si elle s’inscrit dans un vocabulaire marxiste, passe pour être politiquement révolutionnaire, mais qui me paraît, finalement, avoir des effets tout à fait différents.
Je considère que ma tâhe est de donner le maximum de chances à la multiplicité, à la rencontre, à l’impossible, à l’imprévisible… Cette manière d’interroger l’Histoire à partir de ces jeux de possibilité et d’impossibilité est à mes yeux la plus féconde quand on veut faire une histoire politique et une politique historique. A la limite, on peut penser que c’est le plus impossible qui est finalement devenu le nécessaire. Il faut donner son maximum de chances à l’impossible et se dire : comment cette chose impossible s’est-elle effectivement produite ?
Montrer que l’asile ou la prison n’ont rien d’inéluctable, c’est aussi les combattre…
Je crois, à la suite de Nietzsche, que la vérité est à comprendre en termes de guerre. La vérité de la vérité, c’est la guerre. L’ensemble des processus par lesquels la vérité l’emporte sont des mécanismes de pouvoir, et qui lui assurent le pouvoir.
C’est une guerre permanente ?
Je pense, oui.
Dans cette guerre, quels sont vos ennemis ?
Ce ne sont pas des personnes, plutôt des espèces de lignes qu’on peut trouver dans des discours, et même éventuellement dans les miens, et dont je veux me départir, et me démarquer. Pourtant, c’est bien de guerre qu’il s’agit, puisque mon discours est instrumental, comme sont instrumentales une armée, ou simplement une arme. Ou encore un sac de poudre, ou un cocktail Molotov. Vous voyez, cette histoire d’artificier, on y revient.